  

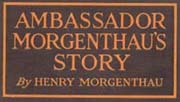
© 1918.
Henry Morgenthau
Ambassadeur Américain à Constantinople
1913-1916
CHAPTER XXIV
Le meurtre d’un nation
La destruction de la race arménienne , en 1915, a
dû faire face à des difficultés qui ne s’étaient pas rencontrées lors des massacres
perpétrés pas les Turcs à partir de 1895. Au XIXème siècle, les Arméniens n’avaient
que peu de moyens de résistance. A cette époque, ils n’avaient pas accès au service
militaire, ne pouvaient pas s’engager dans l’armée turque ou posséder des armes.
Comme je l’ai déjà dit, ces discriminations disparurent en 1908 lors de l’arrivée
au pouvoir des révolutionnaires. A compter de ce jour, les Chrétiens avaient non
seulement l’autorisation de porter des armes mais y étaient même encouragés par les
autorités emportées par leur enthousiasme pour la liberté et l’égalité. En
conséquence, début 1915, chaque ville turque abritait des milliers d’Arméniens
sachant manier les armes et possédant des fusils, pistolets et autres moyens de défense.
La résistance arménienne de Van avait prouvé une fois de plus que ces hommes pouvaient
tirer parti de leurs armes. Il devenait donc évident que le massacre des Arméniens cette
fois-ci ressemblerait plus à une guerre qu’à une boucherie d’hommes et de femmes
sans défense que les Turcs avaient jusque là perpétrée. Pour que ce projet d’extermination
de toute une ethnie réussisse, deux conditions devaient être réunies : il serait
nécessaire que les soldats arméniens soient impuissants et que les armes soient
retirées de chaque ville et village arménien. Pour que le peuple arménien puisse être
massacré, il devait se trouver sans défense.
Début 1915, le statut des soldats arméniens dans l’armée
turque fut modifié. Jusque-là, la plupart d’entre eux avaient été des combattants.
Désormais, ils se retrouvaient dépouillés de leurs armes, simples travailleurs. Au lieu
de servir leur pays dans l’infanterie ou l’artillerie, ces anciens soldats
découvraient qu’ils étaient maintenant devenus des bêtes de somme ou cantonniers. Ils
devaient porter sur leurs dos les sacs de l’armée. Trébuchant sous ce fardeau, sous
les fouets et les baïonnettes des Turcs, ils étaient contraints de traîner leurs corps
épuisés à travers les montagnes du Caucase. Parfois, ils devaient tracer leur chemin,
pliés sous le poids de leur charge, avec de la neige jusqu’à la taille. Ils passaient
presque tout leur temps à l’air libre, dormant à même le sol lorsque les mauvais
traitements incessants des chefs leur laissaient assez de répit pour dormir. On ne leur
donnait que des restes de nourriture. S’ils étaient malades, ils étaient abandonnés
là où ils étaient tombés ; leurs oppresseurs turques s’arrêtant juste le temps de
les dépouiller de leurs tout ce qu’ils possédaient, y compris leurs vêtements. S’ils
parvenait à rejoindre leur destination, il était fréquent qu’ils soient massacrés.
Il existe de nombreux exemples de soldats arméniens exécutés de façon sommaire puisqu’il
était d’usage de les tuer de sang-froid. Le déroulement des exécutions suivait un
cérémonial bien précis. Ici et là, des groupes de cinquante à cent hommes étaient
faits prisonniers, enchaînés les uns aux autres par groupes de quatre, puis emmenés à
l’écart du village. Tout à coup les coups de fusils déchiraient l’air, et les
soldats turques servant d’escorte revenaient seuls au camp. Ceux envoyés pour enterrer
les corps les découvraient presque toujours complètements nus car les Turques avaient
volé tous leurs habits. Dans d’autres cas que j’ai rencontrés, les meurtriers
poussaient le raffinement jusqu’à les obliger leurs victimes à creuser leurs tombes
avant d’être abattus.
Je vais maintenant vous rapporter un épisode
consigné dans les rapports de nos consuls et qui se trouve désormais dans les archives
du Département d’Etat Américain. Début juillet, 2000 Arméniens amélés (c’est
ainsi que les Turques nomment les soldats réduits à la condition d’hommes de charge)
ont été envoyés à Harpoot pour construire des routes. Les Arméniens de cette ville
comprenaient bien ce que cela signifiait et supplièrent le gouverneur d’avoir pitié.
Il les rassura, promettant que les hommes ne seraient pas blessés. Il fit même appel à
un missionnaire allemand, M.Ehemann, pour apaiser leurs craintes, lui donnant sa parole d’honneur
que les anciens soldats seraient protégés. M. Ehemann crut le Gouverneur et apaisa les
peurs de la foule. Pourtant, chacun de ces deux mille hommes ou peut s’en faut fut
massacré, et leurs corps jetés dans une grotte. Quelques uns en réchappèrent, et c’est
par eux que la nouvelle du massacre atteignit le monde. Quelques jours plus tard, deux
mille soldats supplémentaires furent envoyés à Diarbekir. Ces hommes furent expédiés
à la campagne dans le seul but d’y être massacrés. Afin qu’ils n’aient pas la
force de résister ou de s’enfuir, ces pauvres créatures étaient systématiquement
affamées. Des agents du gouvernement les précédaient sur le chemin, informant les
Kurdes de l’arrivée de la caravane et leur ordonnant d’accomplir leur devoir. Non
seulement les Kurdes se précipitaient sur ces régiments affamés et à bout de forces
depuis les montagnes ; mais les femmes Kurdes les tuaient avec des couteaux de boucher
afin de gagner aux yeux d’Allah le paradis promis pour meurtre d’un Chrétien. Ces
massacres n’étaient pas des actes isolés. Je pourrais rapporter de nombreux autres
épisodes tout aussi horribles que celui relaté précédemment. A travers l’Empire
turc, se perpétraient des assassinats systématiques de tout homme robuste, et ce non
seulement pour se débarrasser de tout mâle pouvant engendrer une nouvelle génération d’Arméniens,
mais aussi pour de faire de la population la plus faible une proie facile.

Fig. 43. Abdülhamid.
L’Histoire l’a retenu sous le nom de “Sultan Rouge”, et Gladstone l’a décrit
comme “le grand assassin”. Sa politique était de résoudre le problème arménien en
exterminant ce race. Seule la peur de l’Angleterre,
de la France, de la Russie et de l’Amérique pouvait le limiter dans l’accomplissement
de sa tâche. Ses successeurs, Talaat et Enver, ne craignant plus ces pays, continuèrent
son programme avec
succès.

Fig. 44. Vue
de la campagne Arménienne
Aussi horribles les massacres de ces soldats sans
armes soient-ils, ils étaient la justice et la pitié incarnées comparés au traitement
qui était maintenant infligé aux Arméniens que l’on suspectait de cacher des armes.
Bien sûr, les Arméniens se sont inquiétés quand des affiches ordonnant à tous d’apporter
leurs armes au quartier général ont été placardées dans les villes et les villages.
Bien que ces ordres soient adressés à tous les citoyens, les Arméniens comprenaient
quel serait le résultat s’ils étaient laissés sans défense, tandis que leurs voisins
musulmans avaient l’autorisation de garder leurs armes. Cependant, dans de nombreux cas,
les personnes persécutées obéirent sans résistance à l’injonction. Et c’est
presque avec jubilation que les officiels turcs saisirent les fusils comme preuve de l’organisation
d’une révolution et jetèrent leurs victimes accusées de trahison en prison. Des
milliers d’Arméniens ne rendirent pas leurs armes pour la simple raison qu’ils n’en
possédaient pas. Un nombre encore plus important refusa obstinément de les rendre, non
pas parce qu’ils prévoyaient de se soulever mais parce qu’ils souhaitaient défendre
leur vie et l’honneur de leurs femmes contre les atrocités qu’ils savaient prévues.
Le châtiment infligé aux récalcitrants constitue l’un des chapitres les plus
horribles de l’histoire moderne. La plupart d’entre nous pense que la torture a cessé
depuis longtemps d’être une pratique administrative et judiciaire. Pourtant, je ne
pense pas que les périodes les plus sombres de notre histoire aient connu des scènes
aussi horribles que celles qui se déroulèrent à travers la Turquie. Pour les gendarmes
turcs, rien n’était sacré. Sous couvert de chercher des armes cachées, ils mirent les
églises à sac, sans aucun respect pour les autels et les objets sacrés. Ils mirent en
scène de fausses cérémonies imitant les rites chrétiens. Ils battaient les prêtres
jusqu’à ce qu’ils soient inconscients, sous prétexte qu’ils étaient au centre de
la sédition. Quand ils ne pouvaient pas découvrir d’armes dans les églises, il leur
arrivait d’armer les évêques et les prêtres avec des fusils, des pistolets ou des
épées avant de les juger en cour martiale pour possession illégale d’armes, puis de
les faire marcher ainsi dans les rues, dans le seul but de générer la colère fanatique
des foules. Les gendarmes traitaient les femmes avec la même cruauté et la même
indécence que les hommes. Il existe des exemples connus où des femmes accusées de
cacher des armes étaient déshabillées et fouettées avec des branches d’arbres
fraîchement coupées. Même les femmes enceintes étaient battues. Les viols
accompagnaient si souvent ces recherches qu’à l’approche des gendarmes les filles et
femmes arméniennes s’enfuyaient vers les bois, les collines ou les contreforts des
montagnes.
Au début des recherches, les hommes forts des
villes et des villages étaient arrêtés et jetés en prison. Les bourreaux exerçaient
sur eux une ingéniosité des plus diabolique afin que leurs victimes s’avouent «
révolutionnaires» et révèlent l’endroit où ils avaient caché leurs armes. Il n’était
pas inhabituel qu’un prisonnier soit placé dans une pièce avec deux Turques à chaque
bout et de chaque coté. L’interrogatoire commençait par le « bastinado », forme de
torture assez commune en Orient. Il s’agit de battre la plante des pieds avec une fine
baguette. Dans un premier temps, la douleur n’est pas très marquée, mais comme le
procédé continue inexorablement, il se transforme horrible agonie. Les pieds gonflent et
se percent, et il est courant qu’après un tel traitement il faille les amputer. Les
gendarmes torturaient ainsi leurs victimes jusqu’à ce qu’elles s’évanouissent. Ils
les réveillaient en leur jetant de l’eau à la figure et recommençaient. Si ce n’était
pas suffisant pour pousser les victimes à avouer, ils avaient d’autres méthodes de
persuasion. Ils arrachaient les sourcils et barbe un à un, ils extrayaient les ongles des
mains et des pieds, ils marquaient au fer rouge les poitrines, ils déchiraient les chairs
avec des tenailles brûlantes avant de verser du beurre bouillant dans les plaies. Parfois
les gendarmes leur clouaient les mains et les pieds à des bouts de bois dans une parodie
de la crucifixion du Christ. Quand le torturé se contorsionnait de douleur, ils criaient
: « Maintenant demande à ton Christ de venir t’aider. »
Ces cruautés, ainsi que beaucoup d’autres que je
n’ose décrire, étaient souvent perpétrées de nuit. Des Turcs étaient postés autour
des prisons. Ils étouffaient les cris des martyrisés en tapant sur des tambours et en
sifflant afin que les villageois ne les entendent pas. Dans des milliers de cas, les
Arméniens enduraient ces tortures et refusaient de rendre leurs armes pour la simple
raison qu’ils n’en possédaient pas. Pourtant rien ne pouvait persuader leurs
bourreaux que tel était le cas. Les populations prirent alors l’habitude, en apprenant
l’arrivée prochaine des gendarmes, d’acheter des armes qu’elles pourraient ensuite
rendre afin d’échapper au châtiment.
Je discutais un jour de ces procédés avec un
officiel Turc qui décrivait les tortures infligées. Il ne cacha pas que le gouvernement
avait enquêté sur le sujet et que, comme tous les hauts fonctionnaires, il avait
approuvé avec enthousiasme le traitement infligé à cette race haie. Cet officiel m’a
certifié que les détails étaient discutés de nuit au quartier général du Comité
Union et Progrès. Chaque nouveau moyen d’infliger la douleur était salué comme une
découverte magnifique, et les participants réguliers ne cessaient de se creuser les
méninges pour inventer de nouvelles méthodes de torture. Il me raconta qu’ils s’étaient
même plongés dans les dossiers de l’Inquisition espagnole et autres anciennes
institutions pratiquant la torture et avaient adopté les suggestions qu’ils y avaient
trouvées. Il ne me dit pas qui avait gagné le premier prix dans cette abominable
compétition. Cependant, à travers l’Arménie, la rumeur l’attribuait généralement
à Djevdet Bet, le Vali de Van, dont j’ai précédemment décrit les activités de
torture. À travers le pays, Djevdet était généralement connu comme le « forgeron de
Bashkale ». Ce maître ès torture avait inventé ce qui était probablement un travail
de maître : la pratique de clouer des fers à chevaux aux pieds de ses victimes
arméniennes.
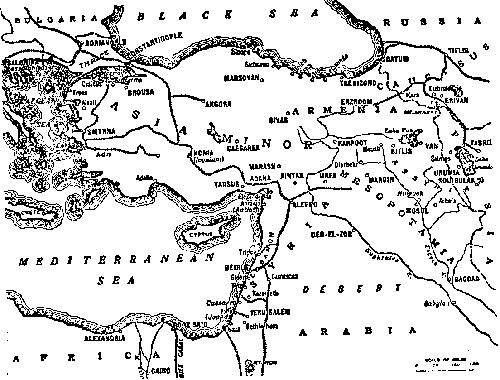
Map 5. l’Arménie
Et pourtant aucun de ces faits ne constituait ce que
les journaux de l’époque appelaient « les atrocités faites aux Arméniens ». Ce n’étaient
que les préliminaires à la destruction de tout un peuple. Les Jeunes Turcs firent
preuves de plus d ‘imagination que leur prédécesseur Abdülhamid. L’ordre donné par
le sultan déchu était seulement de » tuer, tuer », tandis que la démocratie turque
fomenta un projet totalement nouveau. Plutôt que de massacrer sur le champ toute la race
arménienne, elle serait déportée. Au sud et sud-est de l’empire ottoman se trouvaient
le désert syrien et la vallée de la Mésopotamie. Bien que des régions de cette
contrée aient un jour abrité une civilisation fleurissante, elles avaient souffert le
sort de tout pays soumis au pouvoir turc. C’était maintenant une terre inhospitalière,
morne et désolée, sans ville ni village ni aucune forme de vie, peuplée seulement de
quelques tribus bédouines sauvages et fanatiques. Seul un travail conséquent, effectué
sur plusieurs années, pourrait transformer ce désert en un endroit capable d’accueillir
une population importante. Le Gouvernement Central annonça son souhait de rassembler les
deux millions d’Arméniens vivant dans différentes régions de l’Empire et de les
déporter dans cette contrée désertique et inhospitalière. S’ils avaient entamé
cette déportation de bonne foi, elle aurait représenté le summum de la cruauté et de l’injustice.
En fait les Turcs ne souhaitaient absolument pas établir les Arméniens dans ce nouveau
pays. Ils savaient que la grande majorité n’atteindraient jamais leurs destinations et
que ceux qui y parviendraient mourraient soit de soif, soit de faim, soit assassinés par
les tribus mahométanes du désert. Le vrai but de la déportation était le vol et la
destruction. Il s’agissait vraiment d’une nouvelle méthode de massacre. Quand les
autorités turques donnèrent l’ordre de procéder aux déportations, elles
condamnèrent de facto toute une race à mort. Elles en étaient parfaitement conscientes
et ne firent rien pour le dissimuler au cours des conversations que j’eus avec certains
fonctionnaires.

External Image: Library of Congress
Les déportations se déroulèrent au cours du
printemps et de l’été 1915. Parmi les villes les plus importantes, Constantinople,
Izmir (Smyrna) et Alep furent épargnées. Presque tous les autres lieux où vivaient des
Arméniens furent la scène de ces tragédies sans nom. Aucun Arménien quels que soient
son éducation, revenu ou classe sociale ne fut exempté. Dans certains villages, des
affiches étaient placardées, ordonnant à l’ensemble de la population arménienne de
se présenter dans un endroit public à un moment déterminé, la plupart du temps un ou
deux jours plus tard. Dans d’autres endroits, un crieur public informait les habitants.
Dans d’autres endroits encore, aucun avertissement n’était donné à l’avance. Les
gendarmes frappaient aux les maisons des Arméniens et leur intimaient l’ordre de les
suivre. La police leur tombait dessus comme l’éruption du Vésuve tomba sur Pompéi.
Les femmes étaient sorties des baignoires, les enfants de leur lit, le pain laissé à
moitié cuit dans les fours, les repas de famille abandonnés à moitié consommés, les
enfants enlevés des salles de classe, laissant leurs livres ouverts à la leçon du jour,
et les hommes étaient obligés d’abandonner leurs charrues dans les près et leur
bétail sur les pentes des montagnes. Même les femmes qui venaient d’accoucher étaient
obligées de quitter leur couche et de rejoindre la foule paniquée, leurs bébés
endormis dans les bras. Les quelques objets qu’elles parvenaient à rassembler
rapidement (un châle, une couverture, parfois quelques morceaux de nourriture) étaient
les seuls biens personnels qu’elles pouvaient emmener. En réponse à leurs questions
frénétiques « où allons nous ? » les gendarmes opposaient toujours la même réponse
: « Dans les terres ».
Dans la plupart des cas, les réfugiés disposaient
de quelques heures ; dans certains cas exceptionnels de quelques jours se débarrasser de
leur propriété et du mobilier. Mais l’opération était en réalité assimilable à un
vol. Ils ne pouvaient vendre qu’aux Turcs. Acheteurs et vendeurs savaient qu’ils ne
disposaient que d’un jour ou deux pour vendre ce qui avait été accumulé au cours d’
une vie. Les prix obtenus ne représentaient qu’une infime partie de la valeur réelle.
Les machines à coudre partaient pour un ou deux dollars, une vache pour un dollar, les
meubles d’une maison pour une misère. Dans de nombreux cas, les Arméniens n’avaient
pas le droit de vendre ou les Turcs d’acheter même à ces prix ridicules sous prétexte
que le gouvernement voulait vendre leurs biens afin de payer les créanciers qu’ils ne
manqueraient pas de laisser derrière eux. Les meubles étaient mis dans des magasins ou
entassés sur la place publique où ils étaient le plus souvent pillés par les hommes et
femmes turques. Les fonctionnaires informaient aussi les Arméniens que, entendu que leur
déportation n’était que temporaire et que l’intention était de les rapatrier une
fois la guerre terminée, ils n’avaient pas le droit de vendre leurs maisons. Les
précédents propriétaires avaient à peine quitté les villages que les mohadjirs
mahométants (immigrants issus d’autres régions de Turquie) étaient installés dans
les quartiers arméniens. De la même manière, tous leurs objets de valeur (argent,
bagues, montres et joaillerie) étaient apportés aux postes de police pour « être mis
en sécurité jusqu’au retour de leurs propriétaires » ; puis distribués aux Turcs.
Pourtant ces vols étaient source de peu d’inquiétudes pour les réfugiés tant les
scènes auxquelles ils assistaient étaient plus terribles et angoissantes. L’éradication
systématique des hommes continuait. Ceux laissés en vie par les persécutions décrites
ci-dessus étaient traités violemment. Avant que les caravanes ne se mettent en marche,
il était d’usage de séparer les hommes jeunes des familles, de les attacher les uns
aux autres par groupes de quatre, de les emmener aux abords de la ville et de les
exécuter. Les pendaisons publiques sans procès, le seul tort des victimes étant d’être
arméniens, étaient pratique courante. Les gendarmes se montraient particulièrement
désireux d’anéantir ceux qui étaient éduqués et ceux qui étaient influents. Les
consuls et missionnaires américains ne cessaient de m’envoyer des rapports sur de
telles exécutions, et nombre des événements que j’ai décrits précédemment ne s’effaceront
jamais de ma mémoire. A Angora tous les hommes âgés de quinze à soixante-dix ans
furent arrêtés, attachés ensemble par groupes de quatre et envoyés par la route en
direction de Césarée. Après avoir marché cinq à six heures, ils atteignirent une
vallée retirée. Là, un groupe de paysans turcs leur tomba dessus avec des massues, des
marteaux, des haches, des faux, des pelles et des scies. Non seulement ces outils
causaient-ils des morts bien plus horribles que les revolvers et les pistolets, mais,
comme les Turcs eux-mêmes s’en vantaient, ils étaient plus économiques puisqu’ils
ne nécessitaient pas de gaspiller de la poudre et des balles. Ils décimèrent ainsi
toute la population mâle d’Ankara, y compris les hommes riches et d’influence. Leurs
corps, affreusement mutilés, furent laissés dans la vallée où ils furent dévorés par
les bêtes sauvages. Une fois le massacre terminé, les paysans et les gendarmes se
retrouvèrent dans une taverne locale pour comparer leurs butins et s’enorgueillir du
nombre de « giaours » que chacun avait tué. À Trabzon, les hommes furent transférés
par bateaux et expédiés sur la mer Noire. Les gendarmes suivaient dans d’autres
embarcations, les exécutaient puis jetaient leurs cadavres à l’eau.
Par conséquent, quand les caravanes recevaient l’ordre
de s’ébranler, elles étaient presque toujours uniquement constituées de femmes, d’enfants
et de vieillards. Quiconque aurait pu les protéger du destin qui les attendait avait
été tué. Il n’était pas extraordinaire que les maires souhaitent à la foule qui se
mettait en mouvement un « bon voyage » moqueur. Avant le départ, les femmes se voyaient
parfois offrir la possibilité de devenir Mahométanes. Même si elles acceptaient cette
nouvelle religion, ce que peu d’entre elles faisaient, leurs problèmes terrestres ne s’arrêtaient
pas là. Les converties étaient obligées de placer leurs enfants dans un « orphelinat
musulman » et d’accepter qu’ils soient instruits à suivre dévotement le Prophète.
Elles-mêmes devaient prouver la sincérité de leur conversion en abandonnant leurs maris
chrétiens et en mariant avec des musulmans. Si aucun bon mahométan ne s’offrait pour
époux, alors les converties étaient déportées, même si elles professaient de façon
véhémente leur foi en l’Islam.

Fig. 45. Un
village de pêcheurs sur le lac Van. Dans cette région environ 55 000 Arméniens furent
massacrés.

Fig. 46.
Van : Réfugiés
rassemblés autour du four public dans l’espoir d’avoir du pain. Ces Arméniens furent
déracinés de leurs maisons pratiquement sans préavis, et commencèrent à traverser le
désert. Par milliers, enfants, femmes, hommes moururent au cours de ces voyages forcés,
non seulement de faim ou d’insolation, mais aussi des conséquences de la cruauté
inhumaine de leurs gardes.
Au début, le gouvernement se montrait
disposé à protéger les colonnes. Les officiers les divisaient en convois de plusieurs
centaines ou de plusieurs milliers d’individus. Parfois, les autorités civiles
fournissaient des charrettes à bœufs qui transportaient les meubles que les exilés
avaient réussi à rassembler. Des gendarmes accompagnaient chaque convoi, officiellement
pour le guider et le protéger. Les femmes, très peu vêtues, portaient leurs bébés
dans les bras ou sur leur dos et marchaient à côté d’hommes infirmes. Les enfants
couraient. Au début, ils prenaient le déplacement à la légère. Il arrivait que des
personnes plus aisées aient un cheval ou un âne. Parfois un fermier avait sauvé une
vache ou un mouton, qui se traînait péniblement à ses cotés, et les animaux
domestiques habituels (chiens, chats et oiseaux) faisaient partie de cette procession
bigarrée. Issues de milliers de villes et villages arméniens ces caravanes se mettaient
en route. Elles remplissaient toutes les routes menant vers le sud. A,u cours de leurs
avancées, elles soulevaient la poussière et abandonnaient débris, chaises, couvertures,
draps, ustensiles de cuisine et autres impedimenta , marquant leur avancée. Quand les
caravanes démarrèrent, les individus avaient visages humains. Quelques heures plus tard,
la poussière s’était déposée sur les visages et les vêtements ; la boue séchait
sur les membres inférieurs. La cohorte avançait lentement, courbée sous la fatigue et
affolée par la brutalité de ses « protecteurs ». On aurait dit une nouvelle et bizarre
espèce d’animaux. Pendant presque six mois, d’Avril à Octobre 1915, la
quasi-totalité des routes d’Asie mineures fut encombrée par ces groupes d’exilés d’un
autre monde. On pouvait les voir entrer et sortir des vallées, escalader les pentes de
presque toutes les montagnes. Avancer toujours et encore, sans savoir où, si ce n’est
que chaque route menait à la mort. Village après village, ville après ville, dans les
pénibles conditions déjà décrites,la population arménienne était évacuée. On que
pendant ces six mois, environ 1 200 000 personnes commencèrent leur voyage vers le
désert syrien.
« Priez pour nous » disaient-ils en quittant leurs
maisons ; ces maisons où leurs ancêtres avaient vécu pendant plus de 2500 ans. « Nous
ne nous retrouverons pas dans ce monde, mais un jour nous nous retrouverons. Priez pour
nous. »
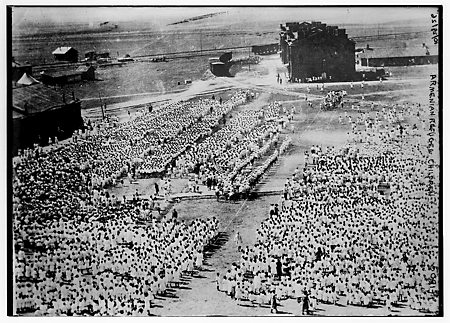
External Image: Library of Congress
Les Arméniens avaient à peine quitté leur village
natal que les persécutions commençaient. Les routes qu’ils empruntaient n'étaient que
des chemins destinés aux ânes. Au fur et à mesure, ce qui avait commencé comme une
longue procession ordonnée se transformait en masse échevelée et désordonnée. Les
femmes étaient séparées de leurs enfants et les hommes de leurs femmes. Bientôt, les
personnes âgées perdirent contact avec leur famille et avancèrent difficilement. Les
conducteurs turcs des charrettes à bœufs, après avoir soutiré jusqu’au dernier sous
de leur charge, les laissaient brusquement avec leurs biens sur le bord de la route et s’en
retournaient vers le village et leurs prochaines victimes. Par conséquent, très
rapidement, jeunes et vieux, furent contraints de voyager à pieds. Les gendarmes envoyés
par le gouvernement, officiellement pour protéger les exilés, devinrent rapidement leurs
bourreaux. Ils suivaient leurs charges avec des baïonnettes au fusil et poussaient
quiconque semblait ralentir le pas. Ceux qui essayaient de s’arrêter pour se reposer ou
tombaient d’épuisement sur la route étaient obligés de rejoindre le convoi de
manière extrêmement brutale. Ils poussaient même les femmes enceintes avec leurs
baïonnettes. Si l’une d’entre elles, ce qui était fréquent, accouchait en route,
elle était immédiatement obligée de se relever et de rejoindre les marcheurs. L’ensemble
du trajet était une lutte permanente avec les habitants musulmans. Des détachements de
gendarmes partaient en éclaireurs informer les tribus kurdes de l’approche de leurs
victimes. Les paysans turcs étaient eux aussi prévenus de l’imminence de l’arrivée
des convois. Le gouvernement ouvrait même les prisons et libérait les condamnés à
condition qu’ils se conduisent comme de bons musulmans à l’approche des arméniens.
Par conséquent chaque caravane devait constamment lutter pour sa survie contre une
succession d’ennemis : les gendarmes qui les accompagnaient, les paysans et villageois
turcs, les tribus kurdes et les bandes de Chétès ou de brigands. Il ne faut pas oublier
que les hommes qui auraient pu défendre leurs compagnons de route avaient presque tous
été tués ou enrôlés de force dans l’armée comme hommes de charge, ni que les
exilés eux-mêmes étaient systématiquement privés de toutes leurs armes avant que le
voyage ne commence.
Plusieurs heures après le départ, les Kurdes
fondaient sur leurs victimes depuis leurs habitations dans les montagnes. Se précipitant
sur les jeunes filles, ils soulevaient leur voile et capturaient les plus jolies. Ils
enlevaient autant d’enfants qu’ils le souhaitaient et volaient sans vergogne le reste
de la troupe. Si les exilés avaient apporté de l’argent ou de la nourriture, leurs
assaillants s’en emparaient, les condamnant à mourir de faim. Ils volaient leurs
vêtements, laissant parfois hommes et femmes complètements nus. En même temps qu’ils
commettaient ces pillages, les Kurdes massacraient sans entrave et les cris des femmes et
des vieillards s’ajoutaient à l’horreur générale. Dans les villages musulmans, de
nouvelles exactions attendaient ceux qui étaient parvenus à échapper à ces attaques en
rase campagne. Là, la brutalité des Turcs se concentrait sur les femmes. Les violences
commises entraînaient leur mort ou elles devenaient folles furieuses. Après avoir passé
la nuit dans une sorte de campement horrible, les exilés, tout du moins ceux qui avaient
survécu, reprenaient leur chemin le lendemain matin. Plus le voyage durait, plus la
férocité des gendarmes semblait augmenter, comme si le fait que leurs victimes vivent
leur déplaisait. Souvent, quiconque tombait sur la route était passé à la baïonnette
sur le champ. Par milliers, les Arméniens commencèrent à mourir de faim et de soif.
Même quand ils s’approchaient des rivières, les gendarmes leur interdisaient de boire,
dans le seul but de les tourmenter. Le chaud soleil du désert brûlait leurs corps peu
habillés et leurs pieds nus, foulant le sable chaud du désert, étaient si douloureux
que des milliers tombèrent et moururent ou furent tués où ils se trouvaient. Par
conséquent, en quelques jours, ce qui était une procession d’êtres humains se
transforma en une horde trébuchante de squelettes couverts de poussière. Ils cherchaient
de façon frénétiquement des morceaux de nourriture, mangeant n’importe quels aliments
qu’ils pouvaient trouver. Ils devenaient fous suite aux visions horribles qui
remplissaient chaque heure de leur existence. Ils étaient malades à cause des
épidémies qui accompagnent des conditions aussi dures et des privations. Mais toujours
et encore, poussés par les fouets et les bâtons et les baïonnettes de leurs bourreaux,
ils avançaient.
Par conséquent, en se déplaçant, les exilés
laissaient derrière eux une autre caravane : celle des morts et des cadavres non
enterrés, des vieillards et des femmes en phase terminale de typhus, dysenterie ou
choléra. Des supplications pitoyables pour de l’eau et de la nourriture montaient des
jeunes enfants allongés sur le dos. Certaines femmes tendaient leurs bébés à des
inconnus, les suppliant de les prendre et de les sauver de leurs bourreaux. Le cas
échéant, elles les jetaient dans des puits ou les abandonnaient derrière des buissons
afin qu’ils puissent au moins mourir dignement. Une cohorte de jeunes filles, vendues
comme esclaves, généralement pour unmedjidie (quatre-vingt centimes) était laissée
derrière. Après avoir servi les buts brutaux de leur acheteurs, elles étaient forcées
de se prostituer. Une série de campements où malades et mourants se mélangeaient aux
cadavres non enterrés ou à moitié enterrés, marquait l’avancée de la procession.
Une multitude de vautours les suivaient dans les airs, et des chiens féroces les
suivaient constamment, se disputant les corps. Les scènes les plus terribles se
déroulaient au bord des rivières, particulièrement de l’Euphrate. Parfois, quand ils
traversaient le fleuve, les gendarmes poussaient les femmes dans l’eau, tirant sur
toutes celles qui tentaient de se sauver en nageant. Il était fréquent que des femmes
plongent d’elles-mêmes dans la rivière, leurs enfants dans les bras, afin de sauver
leur honneur.

External Image: Library of Congress
Un rapport consulaire rapporte les faits suivants :
« Au cours de la dernière semaine de juin, de nombreux Arméniens d’Erzurum ont été
déportés sur plusieurs jours successifs. La plupart ont été massacrés en chemin,
abattus ou noyés. L’une d’entre eux, Madame Zarouhi, une vieille femme de biens, a
été jetée dans l’Euphrate. Elle s’est sauvée en s’accrochant à un rocher dans
le fleuve. Elle a réussi à rejoindre la rive et à retourner à Erzurum où elle s’est
cachée chez un ami turc. Elle a raconté au Prince Argoutinsky, représentant de « l’Union
Urbaine de toute la Russie » à Erzurum, qu’elle frémissait rien qu’en pensant aux
centaines d’enfants passés à la baïonnette par les Turcs et jetés dans l’Euphrate
et à comment les hommes et les femmes avaient été déshabillés, attachés les uns aux
autres par centaines, abattus puis précipités dans la rivière. Elle a même rapporté
que dans un méandre du fleuve près d’Erzinghan, des milliers de corps formaient un tel
barrage que l’Euphrate avait changé sa course sur environ quatre-vingt dix mètres.
Il est ridicule que le gouvernement turc maintienne
qu’ils ait jamais vraiment eu l’intention de « déporter les Arméniens vers de
nouvelles maisons ». Le traitement infligé aux convois montre clairement la volonté
réelle d’Enver et Talaat. Combien d’hommes exilés vers le sud dans ces conditions
révoltantes arrivèrent à destination ? L’exemple d’une seule caravane montre
comment ce projet de déportation s’est entièrement transformé en un projet d’extermination.
Les détails en question me furent fournis par le Consul américain d’Alep et sont
maintenant archivés au Département de Washington. Le 1er juin, un convoi de trois mille
Arméniens, essentiellement des femmes, des filles et des enfants, quitta Harpoot. Comme d’habitude,
le gouvernement fournit une escorte de soixante-dix gendarmes commandés par un officier
turc, un Bey. Mais, comme d’habitude, ces gendarmes ne furent pas leurs protecteurs mais
leurs bourreaux. A peine les déportés s’étaient-ils mis en marche que le Bey extorqua
400 lires à la caravane, en leur promettant de les garder en sécurité jusqu’à l’arrivée
à Malatia. À peine les avait-il volés du seul bien susceptible de leur procurer de la
nourriture qu’il s’enfuit, les laissant à la merci des gendarmes.
Tout le long du chemin vers Ras-ul-Ain, première
gare sur la ligne de Bagdad, l’existence de ces misérables voyageurs ne fut qu’une
succession d’horreurs. Les gendarmes allaient de l’avant, pour annoncer aux tribus
quasi sauvages des montagnes l’approche des plusieurs milliers de femmes et de filles
arméniennes. Les Arabes et les Kurdes enlevèrent ces dernières ; les montagnards les
attaquèrent de façon répétée , violant et tuant les femmes. Les gendarmes eux-mêmes
participèrent à l’orgie. Les rares hommes qui accompagnaient le convoi furent tués un
à un. Les femmes qui étaient parvenues à conserver de l’argent aux dépends de leurs
bourreaux en le cachant dans leur bouche ou leurs cheveux s’en servaient pour acheter
des chevaux. Mais ils leur étaient constamment volés par les tribus kurdes. Puis, après
avoir battu et volé et violé et tué leurs « protégés » pendant treize jours, les
gendarmes les abandonnèrent. Deux jours après, les Kurdes passèrent le groupe en revue
et rassemblèrent tous les hommes encore en vie. Ils en comptèrent environ 150, de 15 à
90 ans qu’ils massacrèrent jusqu’au dernier. Le même jour ce groupe venu de Harpoot
fut rejoint par un autre convoi venu de Siva. La caravane comptait désormais 18 000
personnes.
Un autre Bey kurde prit le commandement. Pour lui,
comme pour tous les hommes dans sa position, il ne s’agissait que d’une opportunité
pour piller, outrager et tuer. Ce chef de bande rassembla ses hommes et les invita à agir
à leur guise avec les membres du convoi. Jour après jour, nuit après nuit, les plus
jolies filles furent enlevées. Parfois elles revenaient dans un état lamentable qui
racontait combien elles avaient souffert. Les retardataires, quiconque était trop âgé
ou infirme ou malade pour tenir le rythme était immédiatement tué. Chaque fois qu’ils
arrivaient dans un village turc, tous les vagabonds locaux étaient autorisés à s’emparer
des jeunes Arméniennes. Lorsque les rangs éclaircis des exilés atteignirent l’Euphrate,
ils virent les corps de deux cents hommes flottant à la surface de l’eau. Ils avaient
été volés tant de fois qu’il ne leur restait plus que quelques haillons dont les
Kurdes s’emparèrent bientôt. La grande majorité du convoi marcha pendant cinq jours,
presque entièrement nus sous le soleil brûlant du désert. Pendant cinq autres jours,
ils n’eurent pas un morceau de pain ni une goutte d’eau. Les Kurdes vendaient l’eau
entre une et trois lires le verre, et parfois ils jetaient l’eau après avoir été
payés. Ailleurs se trouvaient des puits. Certaines femmes se jetèrent dedans car il n’y
avait pas de corde ou de seau pour tirer l’eau. Bien que ces femmes se soient noyées et
que leurs corps polluent l’eau, le reste du convoi buvait dans ces puits. Parfois, quand
les puits n’étaient pas profonds et que les femmes pouvaient descendre puis ressortir,
les autres se précipitaient sur elles pour lécher ou sucer leurs vêtements mouillés et
sales afin de calmer leur soif. Quelques fois les habitants de villages arabes avaient
pitié d’eux et leur donnaient de vieux morceaux de toile pour se couvrir. Certains
exilés qui avaient toujours de l’argent achetaient des vêtements, mais beaucoup durent
marcher nus jusqu’à Alep. Les pauvres femmes osaient à peine marcher tant elles
avaient honte et avançaient courbées en deux.
Au dix-septième jours, quelques créatures
atteignirent Alep. Des deux convois de 18 000 personnes, seuls 150 femmes et enfants
atteignirent leur destination. Parmi ceux qui n’arrivèrent jamais, quelques une, les
plus séduisantes, vivaient toujours captives de Turcs ou des Kurdes. Tous les autres
étaient morts.

External Image: Library of Congress
Mon seul but, en insistant sur ces faits horribles
est que, sans ces détails, le public anglophone ne pourrait vraiment comprendre ce qu’est
cette nation qu’on appelle la Turquie. Et encore, je n’ai pas raconté les détails
les plus affreux, car le récit complet des orgies sadiques dont les hommes et femmes
arméniens furent victimes ne pourrait jamais être publié en Amérique. Les crimes les
plus pervers que l’âme humaine puisse imaginer, les raffinements de persécution que l’imagination
la plus abjecte puisse concevoir devinrent l’horrible quotidien de ces malheureux. Je
suis convaincu que l’histoire de l’humanité ne contient pas d’épisodes plus
affreux que celui-ci. Les grands massacres et persécutions passés semblent presque
insignifiants comparés aux souffrances de la population arménienne en 1915. Le massacre
des Albigeois au début du XIIIème siècle a toujours été considéré comme l’un des
événements les plus malheureux de l’histoire. Au cours de cette explosion de
fanatisme, environ 60 000 personnes furent tuées. Lors du massacre de la Saint
Barthélémy environ 30 000 personnes perdirent la vie. Les Vêpres Siciliennes, que l’on
avait toujours tenues pour l’une des explosions de fanatisme des plus féroces,
causèrent la mort de 8000 personnes. De nombreux ouvrages ont été écrits sur l’Inquisition
espagnole sous Torquemada. Pourtant au cours des dix-huit années de son administration,
à peine plus de 8000 personnes furent suppliciées jusqu’à ce que mort s’en suive.
Le seul précédent dans l’histoire qui rappelle la déportation des Arméniens est sans
doute l’expulsion des juifs d’Espagne par Ferdinand et Isabelle. D’après Prescott,
160 000 furent déracinés de leur foyer et disséminés au hasard à travers l’Afrique
et l’Europe. Pourtant toutes ces persécutions semblent presque infimes comparées aux
souffrances des Arméniens qui entraînèrent la mort d’au moins 600 000 voire même un
million de personnes. Pourtant ces premiers massacres, comparés aux motivations des
atrocités faites aux Arméniens, ont un point commun que l’on pourrait presque
considérer comme une excuse : ils sont le résultat d’un fanatisme religieux. La
majorité des hommes et des femmes qui les ont instigués croyaient sincèrement qu’ils
servaient fidèlement leur Créateur. Sans aucun doute possible, le fanatisme religieux
est une des raisons qui explique l’immolation par la populace turque et kurde des
Arméniens en sacrifice à Allah. Par contre les instigateurs des massacres n’avaient
pas de tels motifs. Ils étaient presque tous athées, sans plus de respect pour le
Mahométisme que pour le Christianisme. Leur unique raison était une politique d’Etat
préméditée et impitoyable.
Les Arméniens ne sont pas le seul peuple en Turquie
à avoir souffert de la politique de « Turquie aux Turcs ». Ce que je viens de raconter
à propos des Arméniens pourrait aussi être écrit, avec des légères modifications, à
propos des Grecs et des Syriens. En effet, les Grecs furent les premières victimes de l’idéal
nationaliste. J’ai déjà décrit comment, au cours des mois précédents la guerre en
Europe, le gouvernement ottoman commença à déporter ses sujets grecs le long de la
côte d’Asie Mineure. Ces violences engendrèrent peu d’intérêt en Europe et aux
Etats-Unis. Pourtant, en l’espace de trois ou quatre mois, 100 000 Grecs furent
arrachés aux maisons de leurs ancêtres sur le littoral méditerranéen et déportés
vers les Iles Grecques et dans l’intérieur des terres. La plupart du temps il s’agissait
de déportations réelles : les Grecs étaient vraiment déportés vers de nouveaux
endroits et non massacrés. C’est probablement parce que le monde civilisé ne protesta
pas contre ces déportations que le gouvernement turc décida d’appliquer la même
méthode sur une plus grande échelle, non seulement pour les Grecs mais aussi pour les
Arméniens, les Syriens, les Nestoriens et autres peuples sujets. Bedri Bey, le préfet de
police de Constantinople, avoua même à l’un de mes secrétaires que l’expulsion des
Grecs avait été un tel succès qu’ils avaient décidé de l’étendre aux autres
races de l’Empire.
Le martyre des Grecs se déroula donc en deux phases
: la première avant guerre, l’autre au début de 1915. La première concerna
essentiellement les Grecs de la côte maritime d’Asie Mineure. La seconde s’attaqua à
ceux qui vivaient en Thrace et dans les territoires autour de la mer Marmara, des
Dardanelles, du Bosphore et de la côte de la mer Noire. Ces derniers furent envoyés par
centaines de milliers vers l’intérieur de l’Asie Mineure. Les Turcs adoptèrent
quasiment le même procédé pour les Grecs que pour les Arméniens : ils les
incorporèrent dans l’armée ottomane avant de les transformer en travailleurs pour la
construction de routes dans le Caucase et autres scènes de combat. Ces soldats grecs,
comme les Arméniens, moururent par milliers de froid, de faim ou autres privations. De la
même façon, toutes les maisons des villages grecs furent fouillées à la recherche d’armes
cachées. Tout comme leurs compagnons arméniens, les hommes et les femmes furent battus
et torturés. Les Grecs durent se soumettre aux mêmes réquisitions forcées qui, comme
dans les cas des Arméniens, n’était que des pillages à grande échelle’ Les Turcs
tentèrent de convertir les Grecs à l’Islam. Les filles grecques, comme les filles
arméniennes, furent enlevées et emmenées dans des harems turcs tandis que les garçons
grecs étaient kidnappés et placées dans des familles mahométanes. Les Grecs, comme les
Arméniens, furent accusés de déloyauté envers l’Empire Ottoman, de ravitailler les
sous-marins anglais stationnés dans la mer Marmara et d’espionner. Les Turcs
déclarèrent aussi qu’ils n’étaient pas fidèles à l’Empire Ottoman et
espéraient qu’un jour les régions grecques de Turquie retourneraient à la Grèce. Sur
ce point ils avaient indiscutablement raison. Il n’est pas surprenant que les Grecs,
après cinq siècles de souffrances innomables sous le joug des Turcs aient eu hâte de
voir leurs terres retourner à la mère patrie. Les Turcs, comme dans le cas des
Arméniens, profitèrent de cette excuse pour massacrer tout un peuple. Partout les Grecs
étaient regroupés sous la protection de soit disant gendarmes puis déportés, la
plupart du temps à pieds, vers l’intérieur. On ne sait pas exactement combien il y eut
d’exilés, mais les estimations varient entre 200 000 à 1 000 000. Ces caravanes
souffrirent de grandes privations, mais elles ne subirent pas de massacre à grande
échelle comme ce fut le cas pour les Arméniens, et c’est probablement pour cela qu’on
en parle peu. Les Turques ne montrèrent pas cette considération par pitié. Les Grecs,
contrairement aux Arméniens, avaient un gouvernement qui se souciait du sort de sa
nation. A cette époque, les alliés des Allemands craignaient tous que la Grèce ne s’engage
dans la guerre aux cotés de l’Entente. Un massacre de Grecs en Asie Mineure aurait,
sans aucun doute, produit dans la population grecque un état d’esprit tel que leur roi
germanophile n’aurait pas pu empêcher son pays d’entrer en guerre. C’est donc pour
des raisons purement politiques que les Grecs de Turquie échappèrent aux atrocités qui
décimèrent les Arméniens. Mais leurs souffrances n’en sont pas moins terribles. Elles
forment un autre chapitre de la longue liste des crimes pour lesquels la civilisation
tiendra les Turques responsables. |

Chapter Twenty-Five: Talaat tells why he deports the Armenians